 Mercredi 27 avril, grosse journée nettoyage au secteur « Merci la vie » avec Jean Noël et Jean Marc. Réfection des terrasses, nettoyage rampe d’accès à la vire, purge et dégagement falaise à gauche de « La lignée ». La suite WE du 28 et 29 mai …
Mercredi 27 avril, grosse journée nettoyage au secteur « Merci la vie » avec Jean Noël et Jean Marc. Réfection des terrasses, nettoyage rampe d’accès à la vire, purge et dégagement falaise à gauche de « La lignée ». La suite WE du 28 et 29 mai …
Archives mensuelles : avril 2016
La Maison du Roy
Ce hameau situé à 5 km de Guillestre, au confluent du Guil et du Cristillan, s’appelait autrefois Pont la Pierre. La tradition rapporte que Louis XIII se rendant en Italie en 1629 se serait arrêté, le 28 février, à l’auberge située dans ce lieudit. La légende veut qu’il se soit plaint du prix, trop élevé à son gré, des œufs que lui vendait l’aubergiste. « Les œufs sont donc bien rares dans ce pays pour qu’ils soient si chers » dit-il. « Sire » répartit le Queyrassin, « ce ne sont pas les œufs qui sont rares ici, c’est la présence de votre majesté ». Dans les archives du Queyras, ce hameau est appelé « Maison-du-Roy » depuis ce moment en raison d’une « sauvegarde du Roy » accordée à l’aubergiste. Il bénéficia d’une réduction des tailles et d’une exemption de corvée, à condition de fournir à bon prix le gîte et le couvert et ce, pendant toute l’année, aux voyageurs et aux soldats de la garnison de Château-Queyras.
Source: Le courrier du Queyras (août 1971)
En Vallouise, il y a longtemps !
En 1855, le glacier Blanc et Noir se côtoyaient au bout du Pré de Madame Carle. Le récit de B. Tournier paru en 1901 nous fait découvrir cette région du bout du monde, effrayante, sauvage mais belle !
En Vallouise, il y a cinquante ans (par M. B. Tournier)
 Quel que soit le merveilleux et charmant pouvoir de la photographie, du dessin, et même de la peinture, il y a dans la nature des choses qu’ils ne peuvent représenter qu’imparfaitement, et qu’il faut avoir vues pour les connaître. Qui saura jamais ce que sont le désert, la mer, la forêt, la haute montagne, s’il ne s’est trouvé devant eux ? Il en est ainsi du glacier. Il manque quelque chose à ceux qui n’ont pas vu de près ce formidable entassement de neiges persistantes, ou déjà vitrifiées, ces masses mouvementées qui ressemblent tantôt à des cascades, tantôt à de grands fleuves surpris et figés dans leur course ; ce vaste dos qui promène sans effort les débris rocheux détachés des sommets voisins et s’en nettoie sans cesse, les ramenant en moraines serpentueuses sur ses bords ; ces petits lacs d’émeraude ; ces crevasses mystérieuses et effrayantes ; ces renflements hérissés de puissantes arêtes de glaces ; enfin, au bas, la voûte féerique qu’on dirait taillée dans le cristal, et d’où le torrent s’échappe bruyant et joyeux, comme chantant sa naissance et son bonheur de trouver la lumière.
Quel que soit le merveilleux et charmant pouvoir de la photographie, du dessin, et même de la peinture, il y a dans la nature des choses qu’ils ne peuvent représenter qu’imparfaitement, et qu’il faut avoir vues pour les connaître. Qui saura jamais ce que sont le désert, la mer, la forêt, la haute montagne, s’il ne s’est trouvé devant eux ? Il en est ainsi du glacier. Il manque quelque chose à ceux qui n’ont pas vu de près ce formidable entassement de neiges persistantes, ou déjà vitrifiées, ces masses mouvementées qui ressemblent tantôt à des cascades, tantôt à de grands fleuves surpris et figés dans leur course ; ce vaste dos qui promène sans effort les débris rocheux détachés des sommets voisins et s’en nettoie sans cesse, les ramenant en moraines serpentueuses sur ses bords ; ces petits lacs d’émeraude ; ces crevasses mystérieuses et effrayantes ; ces renflements hérissés de puissantes arêtes de glaces ; enfin, au bas, la voûte féerique qu’on dirait taillée dans le cristal, et d’où le torrent s’échappe bruyant et joyeux, comme chantant sa naissance et son bonheur de trouver la lumière.
Dans son ensemble, le glacier forme un tout. On dirait un grand être chargé de concentrer le froid et de représenter sa puissance. En haut, son vaste corps semble se souder à la roche et se confondre avec la neige pure des sommets, pendant que, la tête en bas, logée dans les flancs de la montagne, sa gueule vitreuse vomit sans cesse l’eau glacée.
Le glacier et assurément une des plus grandes curiosités alpestres, une merveille de glace, un chef d’œuvre du froid. Cependant, tout figé, immobile et mort qu’il paraisse, il est en réalité plein de vie. Jamais il ne se repose ; en dessus comme en dessous se fait une œuvre incessante ; il travaille et il est travaillé ; il se détruit et se renouvelle. Puis en vertu des lois admirables de transformation déposées par le Maître ouvrier dans la nature, alors qu’il semble ne pouvoir tirer de son sein que le froid et la stérilité, il devient une puissance bienfaisante, et ne rejette que des trésors de fraîcheur et de vie, qui vont apporter au loin la joie et la fécondité.
Quand on a vu les glaciers, on comprend l’irrésistible attrait qui pousse ceux qui reviennent les visiter ; et ceux aussi qui, épris pour eux de passion ou de curiosité, se sont établis pendant des mois sur leurs bords pour les observer et ravir les secrets de leur mystérieuse existence.
Les Alpes du Dauphiné sont dotées de glaciers magnifiques soit par l’étendue, soit par l’originalité. Le glacier Noir et le glacier Blanc, au fond de la Vallouise, sont de ce nombre. Malheureusement, il manque d’en bas d’un bon point de vue : le premier, tournant et remontant à gauche, va s’enfoncer dans les contours sinueux d’un cirque de roche absolument clos ; le second, suspendu à droite dans une haute vallée, ne présente aussi que son point d’arrivée et de déversement. On ne peut juger de la beauté et de l’étendue de ces glaciers, et généralement des glaciers de la région du Pelvoux, que par des ascensions, ou le passage des cols auxquels ils aboutissent : de là ils sont splendides.
A cette heure, avec le mouvement de recul auquel ils sont soumis, la partie basse de ces glaciers a beaucoup perdu de sa grandeur et de son charme. En se retirant et se séparant, ils ne laissent après eux qu’un dépôt informe et laid, un entassement de pierres et de boues qui s’allongent toujours, un pêle-mêle noirâtre, pour longtemps sans avenir pour la végétation qui seule pourrait l’adoucir. En Suisse, en Savoie et même en Dauphiné, les abords du glacier sont en général plus doux, soit que la retraite en soit moins prononcée, soit que la nature des dépôts soit plus favorable à la végétation. Pendant que la forêt, plus rapprochée, détache sur le blanc des neiges la verdure sombre de ses sapins, ou la silhouette frangée de ses mélèzes, les petites plantes s’avancent aussi de leur côté, et prospèrent dans un terrain qui atteste que depuis assez longtemps l’état des lieux n’a pas aussi sensiblement changé. A Zermatt, par exemple, le pâturage n’en est séparé que par quelques monticules où l’herbe a déjà pris pied ; quelques arbrisseaux s’y sont établis comme pour en voiler la nudité ; les saponnaires surtout les égaient de leurs grandes tiges à fleurs rosées ; la bergeronnette et le rossignol de muraille y font leur apparition ; le mouton, la chèvre, la vache même y trouve à brouter ; et la bergère, le bras en travers sur les yeux pour les abriter du soleil, peut trouver une distraction à son oisiveté en plongeant avec curiosité son œil rêveur dans la mystérieuse voûte de glace. – Ici, il n’y a que désolation et nudité.
Mon but n’est pas de décrire une fois de plus des régions qui l’ont été avec tant de charme et de vérité par MM. Tuckett, Whymper, Guillemin, Duhamel et bien d’autres. Je désire seulement fixer un tableau qui m’a ravi il y a une cinquantaine d’années, et conserver le souvenir des deux glaciers tels que j’eus le privilège de les voir quand ils se rencontraient encore au bout du Pré de Mme Carle.
 Leur masse était alors bien plus considérable. Le glacier Noir descendait lourdement et paresseusement de gauche comme une montagne éboulée, – noir, en effet, tout sali par les débris rocheux qui de tous côtés, dans le grand cirque, avaient roulés sur lui. A droite, juste à sa rencontre, arrivait le glacier Blanc, lui, en effet, bien blanc, propre, brillant, magnifique, tantôt uni, tantôt moutonné. Il ressemblait à un fleuve surpris et figé dans sa course et dans ses efforts. Puis, rencontrant un grand escalier de roc, il finissait par une chute de cent mètres. C’est là, surtout, qu’il était beau avec sa charge d’arêtes de glace aux formes bizarres, souvent immenses, pressées, penchées, qui les faisait ressembler à un peuple vaincu, malheureux, se lamentant, changé en glaçons, – immobiles comme la femme de Loth, et pourtant en marche, et à des degrés divers déjà penchées vers l’abîme. Enfin, au bas, rencontrant son vigoureux voisin noir qui lui disputait la place, il se repliait sur lui-même, se gonflait et se renforçait magnifiquement ; et, sous cet entassement même, s’ouvrait une splendide voûte qui semblait taillé dans du cristal, et finissait en arc surbaissés dans des crevasses mystérieuses. On y entendait tomber et murmurer l’eau ; il y avait d’indéfinissables reflets d’un bleu vert et une lumière de clair de lune.
Leur masse était alors bien plus considérable. Le glacier Noir descendait lourdement et paresseusement de gauche comme une montagne éboulée, – noir, en effet, tout sali par les débris rocheux qui de tous côtés, dans le grand cirque, avaient roulés sur lui. A droite, juste à sa rencontre, arrivait le glacier Blanc, lui, en effet, bien blanc, propre, brillant, magnifique, tantôt uni, tantôt moutonné. Il ressemblait à un fleuve surpris et figé dans sa course et dans ses efforts. Puis, rencontrant un grand escalier de roc, il finissait par une chute de cent mètres. C’est là, surtout, qu’il était beau avec sa charge d’arêtes de glace aux formes bizarres, souvent immenses, pressées, penchées, qui les faisait ressembler à un peuple vaincu, malheureux, se lamentant, changé en glaçons, – immobiles comme la femme de Loth, et pourtant en marche, et à des degrés divers déjà penchées vers l’abîme. Enfin, au bas, rencontrant son vigoureux voisin noir qui lui disputait la place, il se repliait sur lui-même, se gonflait et se renforçait magnifiquement ; et, sous cet entassement même, s’ouvrait une splendide voûte qui semblait taillé dans du cristal, et finissait en arc surbaissés dans des crevasses mystérieuses. On y entendait tomber et murmurer l’eau ; il y avait d’indéfinissables reflets d’un bleu vert et une lumière de clair de lune.
Quelle différence aujourd’hui ! Le glacier Noir s’est retiré, laissant après lui ses affreuses moraines toujours plus grandes, sales, branlantes, si pénibles à traverser ; quant au glacier Blanc, suspendu à cent mètres au dessus de son ancien lit, il a laissé à découvert la roche sur laquelle ses eaux se déversent sans gloire. Les observateurs disent que nos glaciers ont repris leur marche descendante, qu’ils sont en voie d’accroissement, et que la jeunesse actuelle peut espérer de les revoir tels qu’ils étaient dans leurs beaux jours. Si rien d’autre ne doit en souffrir, je ne puis que le lui souhaiter.
La curiosité ne nous eût pas manqué pour aller plus loin ; mais, alors, on n’osait pas même y penser. Rien n’était prévu, organisé, les voies même étaient ignorées ; le glacier était effrayant, et les parois de roches d’apparence infranchissables. C’était l’inconnu ! Il fallait être chasseur de chamois, fugitif, poussé par une nécessité quelconque, pour s’aventurer sur cette masse indéfinie et menaçante. Ces lieux allaient être dévoilés et rendus praticables par les Clubs Alpins ; mais ils étaient encore alors des bouts du monde.
Ce fond des vallées alpestres, spécialement ce fond de la Vallouise, est singulièrement impressionnant. De quelque côté que l’on porte ses regards, on ne voit que neige, glace, graviers, roches immenses, roussies, ravagées, partout closes sauf, en arrière vers l’étroit espace qui fut jadis le Pré de Mme Carle. Quelques touffes rampantes de sabine végètent à peu près seules du côté tourné vers le Sud ; plus loin, du côté du Pelvoux, protégés par sa base même, quelques vernes et mélèzes souffreteux et rabougris, dont plusieurs sont des vieillards de plusieurs siècles. C’est près d’eux que se montre aujourd’hui la masse rougeâtre et rassurante du précieux refuge Cézanne. Tout le reste est nu, déchiré, raclé, stérilisé, et parle de la guerre continue que se livrent ici les éléments.
Le soir surtout, ce coin perdu à quelque chose de sinistre. La masse écrasante du Pelvoux, ces blocs énormes précipités d’en haut, l’étroitesse de la vallée, la solitude absolue, tout y respire la crainte et le souci. C’est une sauvagerie et une solitude que rien n’adoucit ; l’on en est oppressé, et l’on pense avec soulagement à l’ouverture par laquelle on est venu et par laquelle on pourra s’en retourner. On comprend que la poésie antique, ignorante de bien des choses que nous connaissons, ait peuplé d’esprits, de demi-dieux malfaisants ou secourables, les mystérieuses et impressionnantes solitudes des eaux, des forêts, des montagnes. C’était particulièrement impressionnant alors : au sentiment de l’absolue solitude se joignait celui de l’inconnu ; point de refuge pour rassurer le visiteur, et en arrière une population alors assez mal famée.
Il se faisait tard. La sagesse conseillait de partir. Nous regagnâmes le Pré de Mme Carle. Quel pré ! En vain on en cherche l’herbe, et au moins les traces. Les glaciers l’ont enseveli ou dévoré. Il a bien pu être un pré ; pour le moment, ce n’est qu’une petite plaine de graviers à travers laquelle les eaux cherchent en serpentant leur chemin. A la vérité, les héritiers de cette dame n’en feront pas de longtemps gros argent ; mais il aura assez vécu pour valoir à son heureuse propriétaire, qui, elle, n’aura pas eu à risquer sa vie pour le conquérir, l’honneur d’avoir à jamais son nom gravé sur la carte de l’Etat-major, à côte de celui des plus célèbres ascensionnistes de toute nation.
Le soleil se couchait, et nous voulions voir encore. Ces lieux sauvages et désolés semblent posséder le privilège d’être à certains moments les plus beaux, et d’avoir leurs heures de triomphe. Ces déchirures, ces nudités, ces éboulis, ces horribles rochers, ces neiges, n’apportent alors au tableau que des éléments de beauté : les détails disparaissent, les duretés s’adoucissent, les laideurs se voilent ou se transforment ; il ne reste que des masses : et, sur ce fond puissant, comme sur une ébauche vigoureuse et magistrale , le pinceau du grand Artiste se promène et produit en un moment un tableau sublime de grandeur, d’harmonie et de coloris. Tout reçoit une parure vraiment céleste. En haut, dans une zone lumineuse, qui monte et s’éloigne peu à peu, les cimes allumées, dômes, pics, cornes d’or, neiges pures et rougies, se détachent sur un ciel d’outremer rosé, vous ravissent dans les régions du jour et de l’espérance. En bas, dans le fond, se répand un indéfinissable glacis à la fois transparent et intense, qui semble fait de toutes les couleurs, mais où foisonne l’indigo délayé dans l’or. Ce sont les voiles de la nuit qui montent comme poursuivant le jour.
Nus nous attardâmes si fort à ce Pré de Mme Carle, que nous ne pûmes qu’a grand’peine regagner les misérables chalets d’Ailefroide, où il fallait nous résigner à passer la nuit. Ils sont établis vers l’angle Nord du petit delta d’alluvions préservé entre le pied même du Pelvoux et la jonction des deux torrents, celui de Celse-Nière, qui vient du versant Sud du Pelvoux, et celui de Saint-Pierre que nous venons de suivre et qui, en cet endroit, s’est creusé un lit profond. Sur le petit pont branlant et presque à jour qui le traverse, la tête tourne et les genoux fléchissent lorsqu’on regarde cette eau s’enfuir vers un effrayant couloir où elle se débat avec fureur. Le sol est ébranlé, le bruit monte jusque vers la montagne qui le multiplie ; de nuit c’est inquiétant.
Nous allâmes au premier chalet, obstrué de fumier, de branchage, de chèvres, et de vaches guère plus grandes ; nous appelons ! Une femme échevelée se présente. Plus surprise encore que nous, elle ouvre de grands yeux, semble très inquiète de nous voir et très soucieuse surtout de ce que nous demandons à passer chez elle la nuit ; elle semble se demander ce que cela veut bien dire. Elle recule dans son antre noir, et revient suivi d’un homme de mauvaise mine, la tête très enfoncée dans le chapeau. Après quelques pourparlers avec notre guide, dans une langue qui leur était plus familière, ils consentent, comme dans un cas de force majeure, à nous laisser pénétrer dans leur intérieur, une tanière plus qu’un logis, si enfumé, si noir que, sans le feu, on n’aurait su de quel côté se trouvait la cheminée. La réputation, peu flatteuse alors, des habitants de la Vallouise, la mauvaise mine de nos hôtes, la solitude et l’éloignement de tout secours possible, l’inconnu, l’épouvantable bruit du torrent, qui faisait comme trembler le sol de ses secousses et semblait vouloir tout emporter, tout se réunissait à ce moment pour calmer en nous la poésie de la montagne et nous ramener à la réalité. Je ne pouvais m’empêcher, au fond, d’approuver quelque peu la voix féminine qui me disait : « Il eût fallu me croire et ne pas trop s’attarder là haut en dessins et en admiration ».
 On nous parqua sur un peu de paille dans un petit compartiment attenant à la cuisine, au dessus du bétail dont nous entendions tous les mouvements. Nous ne dormîmes pas comme nous aurions voulu. Beaucoup d’insectes – et le torrent semblait redoubler son vacarme comme pour l’imposer à la nuit et régner à son tour sur le silence de la nature. Nous n’avions jamais rien entendu de pareil ; on eût pu se croire au soir d’un nouveau déluge. Nous sourîmes à la lumière du jour. Lassitude, insectes, mauvais logis, tout est vite passé dans l’oubli ; mais nous n’avons jamais oublié la belle soirée passée au Pré de Mme Carle.
On nous parqua sur un peu de paille dans un petit compartiment attenant à la cuisine, au dessus du bétail dont nous entendions tous les mouvements. Nous ne dormîmes pas comme nous aurions voulu. Beaucoup d’insectes – et le torrent semblait redoubler son vacarme comme pour l’imposer à la nuit et régner à son tour sur le silence de la nature. Nous n’avions jamais rien entendu de pareil ; on eût pu se croire au soir d’un nouveau déluge. Nous sourîmes à la lumière du jour. Lassitude, insectes, mauvais logis, tout est vite passé dans l’oubli ; mais nous n’avons jamais oublié la belle soirée passée au Pré de Mme Carle.
Nous restâmes une bonne partie de la matinée à Ailefroide, à flâner, à nous saturer d’air pur, de senteurs alpestres, d’impressions forestières et prairiales, de la vie des gens pauvres, fraternisant avec poules, ânes, vaches, chiens, rossignols de muraille, qui ont toujours aimé les pauvres masures ; enfants surtout, qui firent cercle, me regardant curieusement me couvrir de savon pour m’embellir un peu au rasoir devant un petit miroir piqué au montant de la porte. Nous visitons jardins et chalets, et remarquons d’ingénieuses petites constructions en contrebas dont le toit est presque au niveau du sol, où l’on descend par un escalier extérieur, et dans lesquelles on abrite des provisions de pommes de terre qui ont cru ici et qu’on y retrouve au printemps.
Repassant le pont tremblant et délabré de la veille, où l’eau fait si grand vacarme, nous redescendons par la rive gauche, par un sentier moins doux, mais plus ajouré, bordé de trembles et de bouleaux à l’écorce blanchâtre, sur lesquels, à chaque nœud, sont dessinés comme de grands yeux qui semblent curieux de nous voir passer. Nous nous retournons bien souvent pour envoyer nos adieux et nos regrets au grand Pelvoux, dont le soleil dore en haut les larges épaules. Nous traversons les jolis hameaux des Claux, de la Pisse, de Saint-Antoine, à demi cachés sous les noyers. La population est toute aux champs : au village, rien que des malades ou des enfants. C’est la fin d’août : le temps est plus court qu’ailleurs dans ces vallées, où la mauvaise saison finit tard et commence tôt. L’on sème et l’on moissonne souvent tout à la fois ; bien des gerbes sont déjà étalées au soleil sur les galeries : ici on arrache le chaume fortement odorant ; là on divise et l’on disperse, tout bonnement avec la main, de tout les instruments le plus perfectionné, le fumier que d’autres enterrent avec de misérables attelages, quelquefois formés d’une vache et d’un âne, avec une charrue primitive qui a des rapports si frappants avec celle des Arabes qu’on la dirait héritée des Maures ou Sarrasins qui ont si longtemps occupé les passages des Alpes, et y ont tant laissé de leurs noms et de leurs souvenirs ; nous eûmes même l’occasion de voir des attelages où des femmes tirées à côté d’un âne. Ce n’est donc point une invention ! Mais la légèreté du sol et le peu de profondeur du sillon portent à croire que cette peu digne obligation, imposée quelquefois dans ces parages à la reine de la création, est moins rude que ce qu’on pourrait croire.
On trouve rarement un beau type par ici. Sur le seuil d’une porte arrondie, que les pampres d’une treille ornaient de leurs gracieux festons, nous eûmes pourtant une apparition charmante, digne du pinceau d’un maître. Une jolie paysanne un peu plus bourgeoise, à la figure douce, cœur et croix d’or au cou, amuse un enfant qui rit aux éclats. Pour entretenir sa gaieté, et selon l’usage de toutes les mères, elle lui tient un langage impossible, pousse d’absurde petits cris, et lui débite toute sorte de niaiserie qu’il ne manque pas de prendre pour du bon argent, ou de bonnes raisons, ce qui accroît la satisfaction de la maman, qui, dans la joie de produire son beau poupon, oublie que nous l’admirons bien autant elle-même. Que Dieu les bénisse et les conserve tous les deux !
L’idée nous prit de gravir les pentes d’en face, à la recherche d’un point d’où l’on pût un peu mieux voir le Pelvoux, toujours plus ou moins caché, rogné du moins par quelque repli de montagne, et qui, malheureusement, en Vallouise surtout, manque d’une vue d’ensemble. Il ne se présente tout à fait bien, au complet et dans toute sa beauté, que de loin, ou de haut par quelque forte ascension. Nous grimpâmes assez longtemps par champs et prés sans réussir à notre satisfaction ; mais ce fut encore une bonne journée de saine flânerie, comme il est utile et permis d’en prendre quelque fois. Ensuite, sur une indication du guide, nous allâmes frapper à la porte d’une ancienne maison à l’air quelque peu bourgeois, chez les Morand, braves gens qui voulurent bien nous recevoir et mettre à notre disposition une grande chambre où bien des choses semblaient parler de grandeurs passées. En causant, nous apprîmes que c’est de ce logis que sont sortis les Morand qui se distinguèrent à Lyon, comme les Tholozan de Vars, au point d’y établir leurs noms sur quais, places ou ponts. « Nous sommes pauvres, me dit le patron du lieu : dans ce pays on a bien de la peine à se maintenir. Ont y vit, mais on ne peut pas pousser les enfants, ni même entretenir les maisons. Autrefois, c’était plus facile, et il est sorti de chez nous des savants ; il y a même eu des évêques dans la famille ! ».
Le matin ,nous remarquâmes que nos draps de lit étaient traversés par de forts belles guipures. « Je crois, me dit ma compagne, qu’on nous a fait coucher dans des nappes d’autel, qui seront venus de chez Monseigneur ! ».
Nous prenons très amicalement congé de nos hôtes, et du Pelvoux dont la tête est bien en face. Il va disparaître ; et j’aime à noter que c’est le capitaine Durand, de l’Etat-major, un Aveyronnais, mon compatriote, qui, en 1835, en fit la première ascension, avec sept à huit hommes, pour la triangulation. Il y éleva une pyramide de treize à quatorze pieds autour d’un mélèze qui en avait quinze. C’est la tradition du pays.
C’est par Entraygues et les cols de la Cavale et de Champoléon, en remontant la Ronde, que nous voulions rentrer en Champsaur. Un ami, alors sous-inspecteur des forêts à Embrun, connaissant nos projets et sachant le sentier difficile du côté de Champoléon, avait bien voulu nous promettre d’envoyer au devant de nous, au col, un des ses gardes ; il ne fallait pas manquer à un rendez-vous donné en pareil endroit.
Nous quittâmes Vallouise dès l’après-midi pour aller coucher à la cabane des bergers de Bonvoisin, malgré le temps devenu très lourd et des nuages menaçants. Nous nous enfonçâmes dans la gorge d’Entraygues, par moments si resserrée qu’il n’y a place que pour le sentier et le torrent. Le ciel s’assombrissait, les gros nuages, s’entr’ouvrant, laissaient par moments passer des rayons de lumière qui faisait reluire en avant le glacier si bien nommé la Peyre de Veyre (Pierre de verre ou Verrière de pierre) ; puis des éclairs et des coups de tonnerre de mauvais augure. Bientôt, tout en retentit. C’était magnifique et bien inquiétant ! Nous étions déjà hors de la gorge ; mais il restait une forte montée pour atteindre la cabane. En aurions-nous le temps ?
Il fallait franchir un assez gros torrent trouble et gonflé, et c’était impossible par les pierres. « Je vais vous passer, dit le guide ; j’ai bon dos et je connais la passe. – Eh bien ! passez d’abord le loulou, moi après, et Madame à la fin. » – Très haut rebroussé, et tâtant le sol avec son bâton, il nous tira à son honneur et à notre satisfaction de ce mauvais pas. Mais nous tombions dans un autre, car la pluie se mit à nous envoyer son avant-garde de grosses goutes qui disaient tout. Nous étions jeunes, et pouvions mieux supporter l’essoufflement auquel nous nous obligeâmes. Nous atteignîmes la cabane comme le plus dru s’en mêlait. Nous n’y arrivions pas seuls. De tous côtés accouraient vaches et veaux, chevaux, ânes, tous les pensionnaires de cette belle montagne. C’était comme aux jours de Noé autour de cette arche de salut. Tous eussent bien voulu pénétrer dans ce refuge de quelques mètres ; malheureusement pour eux, on n’y pouvait recevoir que les gens, et il était pénible d’avoir à leur refuser une hospitalité qu’ils venaient successivement demander avec une insistance digne d’un meilleur succès.
L’hôtesse, une brave femme, assez ébouriffée, nous reçut en levant les bras au ciel : « Eh ! pauvre monde, que venez-vous querre ici ? » Les bergers arrivent aussi, couvert de sacs. Après qu’ils eurent reconnu le troupeau, quelques bêtes absentes les inquiétaient. « Avec ce temps, disaient ils, elles peuvent se précipiter ! »
Nous nous séchâmes devant un bon feu de rhododendron et de sabine, et soupâmes principalement d’excellent lait dans lequel fut directement jeté le café. Deux choses troublaient notre satisfaction de nous trouver dans un si précieux abri : c’étaient l’agitation, l’angoisse, les gémissement des pauvres animaux qui se pressaient et faisaient mur devant la cabane, sentant que là était le bonheur : leurs plaintes faisaient pitié ; puis l’intense fumée qui régnait à l’intérieur, à partir de 60 à 80 centimètres du sol, et nous obligeait à nous tenir à demi couchés.
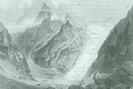 Au dehors, éclairs, tonnerre, averses continuèrent jusque bien avant dans la nuit, que nous passâmes à peu près blanche , et non sans causer beaucoup, car, lorsqu’on sait les faire parler, les pâtres ont plus à dire qu’on ne croit. En tous cas, ils en savent plus que nous sur la région appelée la montagne. Ils nous parlent troupeaux, chamois, herboristes, accidents. Tout près venait de se passer une scène dramatique. Un homme de Vallouise avait commis dans sa propre famille, dit la femme, « un crime que ça ne peut pas se raconter. Mais ça se sut, et il vint se cacher ici, à côté, dans une balme. On le savait, mais il était fort et armé ; comment l’avoir ? Les gendarmes sont fins. Ils se coupèrent la moustache et s’habillèrent en homme du pays. Le brigadier se mit sur la tête un drap comme on en prend à la montagne pour les foins ; il put comme cela monter et s’avancer tout près. L’autre le vit, mais ne se méfia pas et ne le reconnut que quand il fut trop près et lui eut sauté dessus en l’empêchant de prendre le fusil. Ils se roulèrent, mais il le tint jusqu’à ce que le camarade resté en arrière fut arrivé. Ah ! qu’ils l’eurent bien ! Monsieur, ces gendarmes, il faut s’en méfier. Ils les savent toutes ! et ils sont si contents d’attraper quelqu’un ! – Oui, lui dis-je, mais s’ils font la peur des méchants, ils sont les amis et protecteurs des gens de bien ? – ça, c’est vrai ! N’y a qu’à bien faire pour ne craindre ni gendarme, ni personne. »
Au dehors, éclairs, tonnerre, averses continuèrent jusque bien avant dans la nuit, que nous passâmes à peu près blanche , et non sans causer beaucoup, car, lorsqu’on sait les faire parler, les pâtres ont plus à dire qu’on ne croit. En tous cas, ils en savent plus que nous sur la région appelée la montagne. Ils nous parlent troupeaux, chamois, herboristes, accidents. Tout près venait de se passer une scène dramatique. Un homme de Vallouise avait commis dans sa propre famille, dit la femme, « un crime que ça ne peut pas se raconter. Mais ça se sut, et il vint se cacher ici, à côté, dans une balme. On le savait, mais il était fort et armé ; comment l’avoir ? Les gendarmes sont fins. Ils se coupèrent la moustache et s’habillèrent en homme du pays. Le brigadier se mit sur la tête un drap comme on en prend à la montagne pour les foins ; il put comme cela monter et s’avancer tout près. L’autre le vit, mais ne se méfia pas et ne le reconnut que quand il fut trop près et lui eut sauté dessus en l’empêchant de prendre le fusil. Ils se roulèrent, mais il le tint jusqu’à ce que le camarade resté en arrière fut arrivé. Ah ! qu’ils l’eurent bien ! Monsieur, ces gendarmes, il faut s’en méfier. Ils les savent toutes ! et ils sont si contents d’attraper quelqu’un ! – Oui, lui dis-je, mais s’ils font la peur des méchants, ils sont les amis et protecteurs des gens de bien ? – ça, c’est vrai ! N’y a qu’à bien faire pour ne craindre ni gendarme, ni personne. »
Succombant au sommeil et à la fumée, nous laissâmes notre ami et compagnon M. Broux, instituteur, particulièrement amateur de géographie, en discussion avec l’un des pâtres sur la situation du Mont Ararat, que celui-ci soutenait devoir être là, pas bien loin, en Savoie, « puisqu’il y a aussi, pour sûr, disait-il, le Mont Thabor ». Je crains bien qu’avec toute sa géographie l’ami Broux ne soit pas parvenu à le dissuader d’une semblable erreur.
Dès l’aube nous sortîmes fatigués encore, mais bien reconnaissants. Tout était changé : l’air était froid, mais le pâturage rafraichi par ce grand lavage, et le ciel d’une parfaite limpidité ; vis-à-vis, au Nord, le cirque de hautes roches où se concentrent d’immenses glaciers était admirable. Quel dommage de ne faire que passer devant ces magnificences ! Regardons bien du moins, et tâchons d’en emporter l’image durable dans les yeux et dans l’âme.
Le pâtre, depuis longtemps sorti, rentra content d’avoir retrouvé ces génisses, qui, faisant preuve d’une sagesse précoce, s’étaient abritées sous une avance de rocher. Comme il ne peut que bien connaître la montagne, nous le prenons pour nous guider. Il arrive avec son fusil. « Il y a souvent des chamois là-haut, dit-il. –Eh bien ! l’ami, s’il y a des chamois là-haut, je tiens beaucoup à les voir, et non à les effrayer. Aujourd’hui vous êtes à moi, un autre jour vous pourrez y aller pour vous ! » Bien nous en prit, car, après une assez longue ascension, en débouchant sur une croupe, cet homme aux yeux de lynx : « Les voilà ! dit-il, tenez, là, à gauche ; ils vont traverser sur la neige ». Nous étions en face d’un assez grand névé, étendu comme un drap blanc sur l’éboulis qui descendait de la pente même du col que nous allions gravir. Et nous voyons avancer sur cette neige, à portée de fusil, fier, élégant, tête haute, un de ces magnifiques animaux, puis, l’un après l’autre, sans se presser, deux, trois, et jusqu’à quinze. Qu’ils sont beaux, ainsi libres, chez eux, s’harmonisant avec la nature pour laquelle ils ont été faits ! Le névé franchi lentement, les voilà sautant et filant promptement à droite. Mais ce n’est pas fini ! En voici encore un qui s’avance sur la neige. Il se retourne. est-il blessé ? Non, c’est une mère en sollicitude pour un petit qui fait des difficultés pour la suivre. Il vient pourtant ; puis il hésite encore, et la bonne mère l’attend tous les quelques pas. Vers le milieu elle se couche : le petit vient. Alors elle se lève et passe à l’autre bord ; cette fois le petit court après elle, et ils disparaissent bientôt eux aussi dans les rochers.
En haut, sur le col même, quelqu’un debout. C’est sans doute le garde qui nous attend déjà ? Mais, non, c’est encore un chamois qui, les autres passés, s’empresse de les suivre. Ce spectacle ne valait-il pas cent fois le rôti de chamois que nous eût servi quelque hôtesse ?
Le col de la Cavale est pelé, mais doux. Il est double. De Vallouise il aboutit d’abord au sommet de l’Argentière, val étroit, très nu, surtout en haut, mais à belles lignes. Un peu plus bas on aperçoit un petit lac très engageant, un vrai miroir à chamois. C’est un peu plus haut, à droite du col de la Cavale, que se présente celui de Champoléon, où nous vîmes bientôt arriver notre garde avec une ponctualité toute militaire. Ce brave homme nous fut très utile, car des nuages vinrent nous y chercher ; et, sans lui, je ne sais trop comment nous nous serions tirés du sentier glissant, à peine tracé dans les schistes, par lequel débute la descente sur Champoléon.
Je ne m’arrête pas à cette vallée. C’est toujours l’Alpe grandiose et intéressante ; mais de ce côté c’est très long, et rien de particulièrement beau. Il vaut mieux se hâter et regagner le beau et riche Champsaur.
Source : Annuaire du CAF -28ième année – 1901
Le pertuis du Viso
Si vous cherchez une randonnée insolite, si vous souhaitez vous dépayser et découvrir quelque chose de différent dans le Queyras, alors c’est au tunnel de la Traversette qu’il faut aller !
Situé sous le col du même nom, à la limite des communes de Ristolas (05) et Crissolo (Italie), l’ouvrage est creusé entre juin 1479 et novembre 1480, à l’initiative de Ludovic II, marquis de Saluces, pour relier la Provence et le Dauphiné à son marquisat, et en particulier sécuriser la route du sel. Ce projet, présenté au Parlement de Grenoble, reçoit l’aide du roi de France, Louis XI, du marquis de Montferrat et du seigneur de Provence.
D’une longueur de 75 mètres, d’une hauteur d’environ 2 mètres et d’une largeur moyenne de 2,5 mètres la galerie en pente vers le côté piémontais s’étage entre 2900 et 2915 m d’altitude. Il est dimensionné de manière à permettre le passage d’un mulet bâté et d’un homme courbé. L’emprunter permet d’éviter de franchir le col de la Traversette, à 2 947 mètres d’altitude.
Sur le plan économique, il permet de réduire de trois jours le trajet de Grenoble à Saluces, en évitant le duché de Savoie qui contrôle alors le col du Mont-Cenis, ce qui favorise le commerce. Les caravanes reliant la Provence à Turin gagnent jusqu’à trois semaines par rapport à l’itinéraire sud qui emprunte le col de Montgenèvre. De France étaient exporté de nombreux produits – du sel de Provence (Etang de Berre) notamment pour les troupeaux du marquisat, des étoffes, des brocarts et des chevaux. D’Italie étaient importés du riz, de la laine et des peaux. Le sel était stocké dans des greniers notamment à Chateau-Queyras et Guillestre. Les denrées remontaient en barque jusqu’à Savines, en remontant la Durance.
Fermé au XVIe siècle, rouvert puis fermé à plusieurs reprises, le pertuis du Viso a été redécouvert par les alpinistes dans les années 1900, puis restauré en 1907 grâce au concours du Club Alpin Italien, et du Touring Club Français. Sa réouverture a été officialisée le 25 Août 1907. Ce « tunnel du sel » a été aussi notoirement une route de contrebande jusque dans les années 50. En 1997, le Parc Naturel Régional du Queyras et la commune de Ristolas engagent des travaux afin de rendre à nouveau praticable le tunnel aux randonneurs. La dernière restauration date de 2014.
L’histoire prête qu’ Hannibal serait passé par le difficile col de la Traversette en 218 avant Jésus Christ. Difficile d’imaginer un tel périple notamment avec 37 éléphants, 15000 chevaux et 30000 hommes ! Cependant, une analyse carbone de vieux crottins de cheval trouvés dans cette zone datent ceux-ci aux alentours de 200 avant J.C. Hannibal aurait donc pu emprunter l’itinéraire passant par la Haute-Durance …
Source: www.envie-de-queyras.com